Le Loup dans la bergerie. Le fondamentalisme chrétien à l’assaut de l’espace public
Grand résumé de Le Loup dans la bergerie. Le fondamentalisme chrétien à l’assaut de l’espace public, Paris, Les Éditions Labor et Fides, 2012
Suivi d’une discussion par Laurence Kaufmann et Jean-Marc Larouche
Joan Stavo-Debauge
Notes de la rédaction | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur
Notes de la rédaction
La discussion de l’ouvrage Le Loup dans la bergerie par Laurence Kaufmann est accessible à l’adresse : http://sociologies.revues.org/4526 et par Jean-Marc Larouche à l’adresse : http://sociologies.revues.org/4527
« Dans la validation d’un principe ou d’une hypothèse de vérité, on s’intéressera à son origine qui doit avoir ses racines dans l’expérience et à ses effets pratiques, positifs ou négatifs, au lieu de retenir principes et énoncés d’origine sublime venant d’un au-delà de l’expérience et indépendants de leurs effets concrets dans l’expérience. Pour un principe, être élevé, noble, universel et sanctifié par le temps n’est plus suffisant. Il doit présenter son certificat de naissance, montrer dans quelles conditions exactes de l’expérience humaine il a été engendré et enfin, il doit se justifier par ses œuvres actuelles et potentielles ».
John Dewey
« Le respect des droits des croyants implique certainement que le pluralisme existe, mais cela ne signifie pas que ceux-ci, quand ils défendent leurs croyances, défendent ipso facto le pluralisme et le fait que la religion refuse (avec raison) d’attribuer à la vérité scientifique un quelconque caractère absolu et exclusif ne l’oblige nullement à renoncer à l’idée qu'elle détient elle-même bel et bien une vérité de cette sorte ». Jacques Bouveresse
Le Loup dans la bergerie jette un éclairage critique sur les débats relatifs au post-sécularisme qui fleurissent dans les champs de la philosophie politique, de la théorie sociale, de la sociologie et de l’anthropologie. Si le livre discute nombre d’auteurs et revient surtout sur les États-Unis, il concerne aussi l’Europe et s’attache à mettre en cause la voie post-séculariste récemment embrassée par Jürgen Habermas, Charles Taylor ou Jean-Marc Ferry et une ribambelle d’autres philosophes, anthropologues ou sociologues. Pour évaluer sociologiquement les risques de cette voie, je confronte ces discours au monde social, en prenant pour contrepoint les différents avatars du mouvement créationniste 1. Ce mouvement me sert en effet à mettre à l’épreuve le post-sécularisme, en montrant ses vices épistémiques et dangers politiques.
Dans les discussions normatives du post-sécularisme, le créationnisme est souvent évoqué, notamment par Cristina Lafont (2007) et Roberto Frega (2012). Mais à défaut d’une enquête socio-historique appropriée, ces deux philosophes ne voient pas qu’il est beaucoup plus qu’un simple exemple. Aux États-Unis, les tout premiers auteurs à avoir lancé le débat sur le post-sécularisme se recrutaient dans les rangs des fondamentalistes et évangéliques protestants et ils argumentaient très explicitement en faveur du créationnisme : tel est le cas d’Alvin Plantinga (1984) et de Stephen Carter (1987), parmi d’autres. Loin d’être fortuit, le croisement du créationnisme et du post-sécularisme procède de l’activité d’acteurs appartenant à des communautés religieuses engagées dans une entreprise de désécularisation de l’espace public.
Les zélateurs et sympathisants du mouvement créationniste ne s’attaquent pas seulement aux sciences naturelles et à la géographie (Lemartinel, 2012), mais aussi à la philosophie et aux sciences sociales ; le coût d’entrée y est moindre, ils y trouvent des ressources manipulables et des auteurs favorables. Parce que le post-sécularisme consiste à vouloir lever toute restriction à l’expression des convictions religieuses dans l’espace public, il est éminemment profitable au créationnisme et à d’autres mouvements réactionnaires pareillement conduits au nom de dogmes religieux. Tous illustrent la visée post-séculariste d’une complète ouverture de l’espace public aux convictions religieuses, dont nombre d’auteurs nous disent qu’elles auraient pleine légitimité à s’exprimer sans réserve et à fonder à elles seules des décisions politiques valant pour tous et affectant quiconque.
L’ouvrage s’ouvre par des remarques sur la dé-sécularisation tendancielle de la philosophie anglo-américaine et souligne la profonde emprise d’auteurs fondamentalistes sur le champ de la philosophie analytique de la religion. Ils n’ont pas à s’y embarrasser de considérations empiriques, d’herméneutique et d’exégèse biblique ou encore d’histoire et de sociologie des religions pour remettre en selle leur « réalisme théiste » et ficher au cœur de l’espace académique la figure d’un Dieu souverain, causalement impliqué dans la fabrique et les affaires du monde.
Cette branche de la philosophie renoue avec ce que John Dewey décrivait comme « l’esprit apologétique de la philosophie » pré-moderne 4, lorsque « le christianisme médiéval, vers le xiiie siècle, a cherché une présentation rationnelle et systématique » afin de « se justifier au regard de la raison » (Dewey, 2003b, p. 50). Tout comme cette vieille philosophie, la philosophie analytique de la religion fait « grand cas de l’apparat de la raison », du fait « du manque intrinsèque de rationalité dans les questions » dont elle s’occupe, elle semble pareillement « s’être évertuée à développer la pompe de la forme logique » ; « la vérité des doctrines » qu’elle défend ne pouvant « être vérifiée empiriquement, le seul recours consiste à magnifier les signes de rigueur dans la pensée et de rigidité dans la démonstration » (Ibid., pp. 50-51). Si leur diagnostic est tout autre, les zélateurs français de la philosophie analytique de la religion ne dénient nullement cette attache à la scholastique médiévale.
Roger Pouivet, principal importateur de ce style de philosophie en France, le dit clairement, il s’agit de « reformuler d’anciennes thèses métaphysiques, de reprendre les arguments en faveur de l’existence de Dieu » avec « toute la scholastique de la philosophie analytique » pour « produire » un lot « d’affirmations justifiées au sujet de Dieu, de ses attributs, de ses intentions, des valeurs chrétiennes, de la Trinité, de la Rédemption ou de l’Incarnation. Tout comme au bon vieux temps » (Pouivet, 2012). Il omet de dire qu’un tel projet sied à merveille aux croyants fondamentalisés et à leur volonté de prendre la Bible « au pied de la lettre » , en assumant donc crânement le surnaturalisme et l’absolutisme (du pire) du christianisme – très exactement comme le firent les fondamentalistes américains du début du xxe siècle.
Si Le Loup commence par là, c’est que des pièces centrales dans le montage des théories post-sécularistes, notamment la « Reformed Epistemology » de Nicholas Wolterstorff et Alvin Plantinga, s’élaborèrent d’abord dans cet espace académique. Des grands noms de ce champ, tels Alvin Plantinga, Peter Van Inwagen ou William Lane Craig, figurent parmi les compagnons de route du Discovery Institute, think-tank de la droite chrétienne qui rassemble toute la palette des créationnismes sous l’étendard de l’Intelligent Design et attaque sans relâche les institutions scientifiques et l’éducation publique (Forrest & Gross, 2007). Éclairant l’actualité américaine, je rappelle aussi le rôle de ces héritiers du fondamentalisme des années 1920 dans la formation de la droite religieuse et indique son profond impact sur la vie politique américaine, via le bloc électoral des évangéliques blancs, dont près de 80 % ont voté pour le candidat républicain lors des dernières présidentielles.
Cette contextualisation me permet de réinterpréter le mouvement créationniste, premier vecteur de politisation des fondamentalistes et des évangéliques – et véritable laboratoire d’une ingénierie maligne des débats publics. Cette ingénierie a essaimé et œuvre parmi les dénégateurs du réchauffement climatique, où « marchands de doute » (Oreskes & Conway, 2012) et marchands de certitudes s’entendent comme larrons en foire, leurs délires résonnant jusque dans l’enceinte du Congrès américain. Le 25 mars 2010, le Représentant John Shimkus (Républicain de l’Illinois), candidat à la présidence du Comité à l’énergie et au commerce (dont il sera finalement élu vice-président), dira la chose suivante :
« Les très rares fois où nous l’utilisons pour embrasser nos croyances théologiques ou religieuses, le droit à la liberté d’expression est un droit merveilleux dont nous disposons dans ce pays. Sachant qu’il y a ici des membres du clergé parmi les membres de ce panel, je vais donc commencer avec Genèse 8, versets 21 et 22. "Je ne maudirai plus désormais la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises dès l’enfance et désormais je ne frapperai plus tout être vivant, comme je l’ai fait. Désormais, tant que la terre durera, les semailles, les moissons, le froid, le chaud, l’été, l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront point". Je crois que c’est l’infaillible parole de Dieu et que c’est ainsi qu’il en sera pour Sa création. Le second verset provient de Mathieu, 24. "Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre". La terre prendra seulement fin lorsque Dieu déclarera que son temps est venu. L’homme ne détruira pas la terre. Cette terre ne sera pas détruite par un déluge. Et j’apprécie qu’il y ait ici des hommes de foi parmi les panelistes, nous pourrons ainsi approfondir le discours théologique de cette position, mais je crois que la parole de Dieu est infaillible, incorruptible et parfaite » (Stavo-Debauge, 2012, pp. 26-27).
Lorsqu’on se rapporte aux coordonnées des débats en philosophie, on constate que la majorité des théoriciens phares du post-sécularisme 9 ne trouveraient rien à redire, sur le fond, à la prise de parole de ce politicien, estimant qu’il ne fait qu’exercer son droit à la liberté religieuse. Ils rajouteraient que la teneur cognitive des convictions religieuses n’est pas d’un moindre rang épistémique que les assertions factuelles de la science et qu’il n’y a donc aucune raison de restreindre l’entrée des premières dans l’espace public scientifique, délibératif et décisionnel. De manière similaire à Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff, Peter Van Inwagen et Christopher Eberle, Roger Pouivet écrit qu’« on peut montrer la parenté épistémique des croyances religieuses avec celles que peuvent avoir, dans leurs domaines d’expertise, des psychologues, des psychiatres, des sociologues, des historiens, des économistes, des spécialistes de sciences politiques. À mon sens, les croyances religieuses – que Dieu existe, que le Christ, son fils unique, est mort et ressuscité le troisième jour, qu’il reviendra pour juger les vivants et les morts, qui ressusciteront eux aussi – n’ont pas moins de rationalité que celles entretenues par des psychologues au sujet de l’esprit, des sociologues au sujet de la société, des spécialistes de sciences politiques au sujet des rapports géopolitiques » (Pouivet, 2007).
Et du côté des sciences sociales, un bon nombre de sociologues ou d’anthropologues, sans doute convaincus par le « principe de symétrie », tourneraient pudiquement la tête ailleurs, vraisemblablement en se disant avec Bruno Latour qu’il faut se garder de « croire à la croyance » et qu’« on ne croit ni on ne doute "de Dieu" comme on le ferait du "réchauffement global" » (Latour, 2004, pp. 51-53). Le lecteur pourrait croire que j’exagère. Certes, mais ce n’est pas moi qui ai écrit que l’« on peut mettre au crédit des créationnistes d’avoir senti quelque chose de profondément mauvais dans la façon dont l’évolution était vendue au public » et qu’ils « ont au moins la vertu de ne pas avoir abandonné le projet de connecter la religion avec le monde » (Latour, 2009, pp. 468-470). Ce n’est pas moi non plus qui ai mis en valeur la puissance conative du zèle religieux chrétien, en arguant qu’il faut en appeler à la religion devant les dangers qui menacent le globe ; « quand les gens utilisent des "termes apocalyptiques", il est plus sûr de s’en remettre directement à la religion, plutôt que de les utiliser de façon métaphorique » (Ibid., p. 462). Le cas de John Shimkus montre qu’il n’y a là rien de « sûr ». Une attention minimale à l’actualité – allant des profonds méfaits du mouvement du Tea-party aux États-Unis, à la captation des révolutions des pays du Maghreb par l’islamisme politique (Laacher & Terzi, 2012) et jusqu’au « Printemps français » des croyants homophobes – devrait inciter à la prudence.
Il serait donc plus responsable de ne pas se lancer dans des appels inconsidérés à la force conative de la religion et d’éviter les jérémiades contre la « modernité », au motif qu’elle aurait « privé » la religion « de son énergie », « en la réduisant à n’être qu’un ustensile de l’âme » (Latour, 2009, p. 463). Au regard de la vivacité des fondamentalismes religieux, peut-on vraiment dire comme Bruno Latour qu’il est « désirable de réinterroger la sécularisation et de libérer la religion du rétrécissement auquel elle a été forcée afin d’acheter la paix : un état purement individuel, n’ayant publiquement plus de pertinences ontologique, culturelle ou métaphysique » (Latour, 2001) ? Je ne le crois pas, et Le Loup dans la bergerie tente de montrer pourquoi. D’abord en documentant la profonde connivence entre les premiers théoriciens du post-sécularisme et les zélateurs du créationnisme. Ensuite en défendant sociologiquement les restrictions de la « raison publique » rawlsienne (Rawls, 1995 & 1999) contre ses critiques – à la différence de Roberto Frega (2012) et tout comme Philip Kitcher, j’estime que ces restrictions sont défendables dans un cadre pragmatiste
Malgré des instrumentalisations tactiques de principes libéraux, comme la liberté d’expression ou la liberté académique, le ressort principal de mouvements tels que créationnisme réside dans un anti-libéralisme (théologique et politique 12) qui exploite deux dimensions génériques de la foi et pousse les croyants à se mobiliser contre la tolérance religieuse, la différenciation des sphères de rationalité, l’autonomie des sciences institutionnalisées et la sécularisation de l’espace public politique. Réagissant à la transformation des convictions religieuses en préférences privées et en opinions discutables, ces chrétiens fondamentalisés souhaitent reprendre la main et peser à nouveau politiquement, en minant les distinctions entre foi et savoir, entre dogmes religieux et raison publique.
Décomposons ces éléments du premier chapitre, qui articule plusieurs thèses. La première thèse met l’accent sur la dimension conative et motrice de la foi, traitée par Émile Durkheim, Williams James, Paul Ricœur, Michel de Certeau 13, Paul Veyne et Peter Sloterdijk, mais aussi par Jürgen Habermas. Comme je le notais, cette dimension conative du théologique (et de sa violence) semble également enviée par plusieurs philosophes critiques, tels Alain Badiou, Giorgio Agamben et Slavoj Zizek. Dans un même genre, Jean-Claude Monod rappelle que Michel Foucault manifesta une « forme de fascination » à l’égard d’un « personnage qui se posait alors en guide d’une "révolte" théologico-politique, l’ayatollah Khomeiny » (Monod, 2012, p. 121). Si Michel Foucault y voyait l’ouverture d’une « spiritualité politique », il était aussi fasciné par la capacité mobilisatrice de la parole de Khomeiny et donc par la puissance conative du verbe religieux, comme il le confia à Paul Veyne : « Tu comprends qu’on y aille : voilà un homme, qui d’un seul mot prononcé de loin, est capable de jeter des centaines de milliers de protestataires contre les tanks dans les rues de Téhéran » (Ibid., p. 126).
La seconde thèse relève la prétention cognitive de la foi, soulignée notamment par John Dewey, Charles Taylor et Jacques Bouveresse. La capacité de mobilisation du créationnisme tient à la conjonction et à l’exacerbation de ces deux aspects génériques de la foi. J’y vois aussi une modalité de relance de la violence antagonique inhérente à la « distinction mosaïque », thématisée par Jan Assmann (2010) et présente dans les trois monothéismes, au moins à titre d’« événements » et de « moments » consignés dans leurs livres respectifs – et donc constamment réactivable. C’est précisément parce que ses zélateurs s’arc-boutent sur la distinction entre vrai et faux en religion et refusent de céder sur les prétentions cognitives de leur foi qu’ils se vivent comme de plus authentiques croyants ; résolus à en découdre avec les institutions et les savoirs séculiers, qu’ils tiennent pour apostats et antireligieux, ils ne font que relancer le geste de rupture qui hante les trois monothéismes et nourrit leurs prétentions jalouses et militantes à la vérité. Ils rêvent de revenir « en-deçà » de la « révolution moderne des valeurs » 15, afin que la religion redevienne « beaucoup plus qu’un culte personnel ou un "projet de vie" (individuel) » et qu’elle soit à nouveau « l’expression de l’ensemble des valeurs » et « préside à tous les moments de la vie sociale et personnelle, de la naissance à la mort » (Descombes, 2007, p. 332).
Ces croyants fondamentalisés s’en prennent alors aux différentes dimensions de la condition séculière identifiées par Charles Taylor (2007). Ils souhaitent qu’on ne puisse plus ne pas acquiescer à la présence de leur Dieu et à l’idée qu’ils s’en font, dans quelque sphère d’activités que ce soit, d’abord dans le domaine public politique, mais aussi dans les sciences et le monde académique 16. Ils œuvrent ainsi à sécuriser leur propre foi et à l’étendre à la société tout entière, refusant qu’elle ne soit qu’une simple option parmi d’autres, n’exprimant rien de plus qu’une opinion privée dont la validité serait soumise à toutes sortes d’épreuves. Pour cela, ils s’efforcent d’immuniser leurs convictions religieuses contre la critique 17 et de les faire valoir dans des lieux et sur des sujets où elles n’ont aucune autorité et ne sont pas appelées à compter ; ce qui est typiquement le cas de l’activité scientifique 18 et des institutions éducatives.
On peut dire qu’ils cherchent à instrumentaliser et à plier à eux l’instance énonciative de la science, non ses résultats ou ses méthodes. S’il leur est précieux de pouvoir occuper cette instance énonciative, c’est qu’elle permet de se prévaloir d’une autorité épistémique de plus haut rang que de simples opinions, en assertant des « vérités de fait » (Arendt, 1972). Face à leur impossibilité de trouver un équivalent séculier aux contenus à prétention factuelle de leurs convictions religieuses, peu enclins à les faire valoir comme une banale opinion parmi d’autres, il ne leur reste qu’une solution : transformer les institutions et les disciplines du savoir séculier pour les mettre à la dimension de ce qu’ils croient, tout en récupérant la créance d’autorité dont elles bénéficient et la déférence épistémique qu’on leur accorde. Souscrivant à la doctrine évangélique de l’inerrance de la Bible (Plantinga, 2000, p. 384), Alvin Plantinga met en œuvre cette stratégie de captation du crédit d’autorité de la science, arguant d’un « conflit superficiel mais d’un accord profond entre la science et la religion théiste » qu’il oppose à « un accord superficiel mais à un conflit profond entre la science et le naturalisme » (Plantinga, 2011).
Pour rendre compte de l’opposition de ces croyants fondamentalisés à la condition séculière des démocraties libérales, opposition partagée par les amis du post-sécularisme, le second chapitre du Loup dans la bergerie revient sur la spécification de la vertu de tolérance proposée par Jürgen Habermas et décompose les opérations de la grammaire du libéralisme politique 19. J’y montre qu’ils réagissent à ce qu’ils ressentent comme la violence propre de la tolérance qui régit nos espaces publics pluralistes, lesquels requièrent une altération des convictions religieuses pour éviter que la communauté politique ne soit « déchirée par des conflits opposant différentes visions du monde » (Habermas, 2003, p. 163). Et ces croyants fondamentalisés vivent cette altération comme une atteinte à leur foi.
En vue de garantir la paix civile dans la communauté politique, la vertu de tolérance les invite en effet à devoir limiter la portée de leurs convictions, qui ne valent pas pour tous et ne peuvent prévaloir pour tout. En dépit de ce qu’écrit Jürgen Habermas, cette limitation ne laisse pas « intactes » les convictions. La transformation qu’elles ont à subir excède de simples « restrictions imposées à leur efficacité pratique » (Habermas, 2008, p. 263). À l’issue de cette transformation, ceux qui seront alors décrits comme leurs porteurs individuels doivent être capables de les retenir par devers eux et de les verser à leur seul compte, comme une possession privée, sans plus être conduits à se porter au dehors, afin de forcer autrui à reconnaitre leur vérité et les bienfaits qu’elles pourraient produire si tout le monde y adhérait.
La tolérance transforme tendanciellement la foi en option, en préférence et en opinion, privées, ce qui peut être vécu comme une violente dégradation. Gabriel Marcel l’avait remarqué : la « croyance » ne relève pas de prime abord d’une « faculté d’opinion » (Marcel, 1999, p. 303). Mais « n’est-ce pas pour autant que la croyance est devenue opinion, ou plus exactement a tendu à se qualifier elle-même d’opinion, que la tolérance a pu s’introduire dans le monde ? » (Ibid., p. 301). Dans ce geste de conjuration de sa « violence » (Ricœur, 1991), la conviction est alors passible d’une altération plus radicale que Jürgen Habermas ne l’envisage. Paul Ricœur l’a vu, notant que le « prix le plus élevé » tient à ce que cette « ascèse de la conviction risque de se retourner contre elle et de la miner du dedans » (Ibid., p. 305), en inclinant à la « regarder du dehors », « comme une simple opinion, comme une opinion parmi les autres, d’où l’effet d’érosion, d’usure de la conviction ainsi relativisée » (Ibid.).
Afin que la tolérance exerce ses effets pacifiant, la conviction religieuse doit se risquer à devenir une simple « préférence » et à se livrer publiquement dans le seul format de l’« opinion » discutable ; format apprêté pour la pluralité (« une opinion parmi les autres ») et disposé à l’échange au sein d’un espace polyphonique. Se rendre à la discussion qui s’y tient, cela revient à accepter que la conviction soit frappée d’une sorte d’impouvoir au seuil même de son entrée dans cet espace dévolu à l’échange de ce qui doit alors s’y donner comme « avis » ou « opinion », sans assurance d’un partage et sans garantie de pouvoir s’imposer sans partage.
Après avoir montré la tension entre le plaidoyer de Jürgen Habermas en faveur de la vertu de tolérance et sa volonté de récupérer les « ressources sémantiques » des religions, pour des raisons que je rappelle, le chapitre trois s’attache à déconstruire sa position post-séculariste. J’y montre qu’il recycle l’argument de l’« objection intégraliste » (Jensen, 2005), généralement imputée à Nicholas Wolterstorff (1997), mais dont j’ai trouvé les prémisses chez son collègue Alvin Plantinga, dans le célèbre texte « Advice to Christian Philosophers » (Plantinga, 1984), qui lançait conjointement la revue Faith and Philosophy et la Society of Christian Philosophers.
Pour récapituler ses « conseils » aux « philosophes chrétiens », Alvin Plantinga y endosse avec insistance ce motif de l’« intégralité », qu’il présente comme la bonne manière d’investir la foi chrétienne dans le monde académique, en jouant les dogmes de la foi contre les critères épistémiques et les résultats des différentes disciplines scientifiques. Je rajouterai ici que ce texte est célébré par Cyrille Michon et Roger Pouivet dans l’introduction de leur anthologie consacrée à la philosophie analytique de la religion (Michon & Pouivet, 2010). Ils se félicitent qu’Alvin Plantinga y « donne le ton d’une philosophie de la religion engagée et décomplexée » (Ibid.). Je leur accorde qu’il faut être sacrément « décomplexé » pour écrire comme Alvin Plantinga qu’il reviendrait « aux psychologues chrétiens de développer une alternative qui soit en phase avec le surnaturalisme chrétien – une psychologie ayant pour point de départ cette vérité scientifique séminale selon laquelle Dieu a créé l’homme à son image » (Plantinga, 1984). Personnellement, je vois là un geste typiquement fondamentaliste, transformant « les mythes chrétiens en faits scientifiques » et créant « un hybride qui n’est ni de la bonne science, ni de la bonne religion » (Armstrong, 2000, p. 425).
Nicholas Wolterstorff et Alvin Plantinga sont connus pour avoir fondé ensemble le courant de la « Reformed Epistemology », dominant en philosophie analytique de la religion. Naviguant sous la bannière d’une « épistémologie » qui se prétend « modeste », ses zélateurs remettent en cause la distinction de la foi et du savoir. Ils posent que « nos croyances théologiques ne sont pas épistémologiquement différentes de nos croyances perceptives » et « comme elles, nos croyances théologiques sont prima facie justifiées » (Pouivet, 2012). Identifiant la foi à une « connaissance de vérités spécifiques, révélées par Dieu » (Bishop, 2010), ils arguent que les croyances « théistes » sont « basiques » parce qu’elles procèderaient (sans médiation textuelle ou herméneutique) d’une capacité cognitive (le « sensus divinitatis ») à en recevoir la vérité, capacité inscrite par Dieu lui-même en chacun.
Cette « épistémologie », distinctement « fondamentaliste » (Shook, 2010, p. 167), n’est pas étrangère aux débats sur le post-sécularisme, elle y soutient les plaidoyers en faveur d’une inclusion maximale de la religion dans la vie politique et au sein des institutions publiques, non sans défaire toute « distinction de principe » entre la « théocratie » et la « démocratie » (Davenport, 2005). Profitant de l’effacement de la distinction entre foi et savoir produite par cette « épistémologie », l’« objection intégraliste » consiste à dire que la théorie rawlsienne du libéralisme politique viole son propre engagement à l’endroit de la liberté, de la neutralité et de l’inclusion, en restreignant la capacité des citoyens et des acteurs publics à en appeler à leurs convictions religieuses dans l’espace public et politique : « Si quelqu’un essayait de m’empêcher de voter et d’agir politiquement, sur la base de mes convictions religieuses, cela violerait le libre exercice de ma religion » (Wolterstorff, 1997, p. 176). Les restrictions de la « raison publique » reviendraient donc à mettre hors du jeu démocratique tous les citoyens qui ne sont pas en mesure d’y participer en « traduisant » en des raisons séculières ce que commande leur foi religieuse ; une foi qu’ils auraient le droit (et le devoir) de faire valoir et prévaloir dans tous les domaines de leur existence et sur tous les sujets possibles et imaginables 21, « leur obligation d’obéir à Dieu » s’étendant « à la totalité de ce qu’ils font, où qu’ils soient » (Eberle, 2002, p. 145).
S’il critique Nicholas Wolterstorff, Jürgen Habermas reprend la structure de cette « objection », tout en la respécifiant au moyen de la figure de « citoyens monolingues » auxquels il faudrait faire place, « même si la langue religieuse est la seule qu’ils parlent et même s’ils ne veulent ou ne peuvent produire dans la controverse politique que des opinions fondées religieusement » (Habermas, 2008, p. 189). Jürgen Habermas ne s’est pas rendu compte que le croyant que l’« objection intégraliste » faisait rentrer en philosophie politique n’était rien de plus qu’un équivalent fonctionnel de la manière dont les fondamentalistes et les évangéliques aiment à se voir et à être vus – soit comme des chrétiens qui se vivent comme plus authentiques parce qu’ils prétendent donner une portée intégrale à leur foi, dans l’ensemble de leur vie et pour la totalité de la société.
Accepter cette « objection » et avaliser la figuration des croyants qu’elle charrie, c’est faire du fondamentalisme la mesure de l’hospitalité de l’espace public, l’étalon de la justice du libéralisme politique et le critère de la « vraie » foi. Si Jürgen Habermas est tombé dans le piège tendu par Nicholas Wolterstorff et consorts, sa figure des « citoyens monolingues » a malgré tout le mérite de faire ressortir la mauvaise foi de « l’objection intégraliste ». Si Nicholas Wolterstorff argue qu’il ne saurait juger et se prononcer sur des sujets politiques autrement qu’en employant un langage strictement religieux, en prenant donc lui-même la pose d’un citoyen « monolingue » et « intégraliste », c’est néanmoins dans un langage non-religieux qu’il déploie son objection, en se tenant à l’intérieur même de la grammaire libérale (mais pour la faire exploser ). Au-delà de cette contradiction pragmatique, l’« objection » n’est tout simplement pas viable, car les personnes réellement « monolingues » n’existent pas. Et même les fabricants de l’« objection intégraliste » semblent le reconnaître.
En effet, pour l’instant, aucun d’entre eux n’a souhaité que les problèmes publics et les questions politiques soient d’emblée posés dans un langage religieux, afin que les personnes « monolingues » puissent y avoir accès et soient en mesure de se prononcer sur ce dont il est question. La chose serait pourtant requise, car si certaines personnes étaient réellement « monolingues », cela ne signifierait pas seulement qu’elles ne parlent qu’une seule langue, cela voudrait dire aussi qu’elles ne comprennent qu’une seule langue. Ces auteurs estiment donc que même les personnes dites « monolingues » savent de quoi il retourne et comprennent le langage séculier dans lequel les questions politiques sont adressées dans l’espace public. Mais si elles comprennent de quoi il est question, c’est donc qu’elles ne sont pas « monolingues ». Et si elles ne sont pas « monolingues », l’objection « intégraliste » perd de son tranchant.
Les philosophes qui se sont employés à la forger ont donc mis en circulation de la fausse monnaie. Leur « objection » n’est rien de plus que la promotion d’une modalité d’un « croire » peu soucieux de reconnaître l’existence d’un domaine politique autonome et de sphères sociales différenciées. On ne doit donc pas accepter qu’ils se parent d’une fausse incapacité à s’exprimer normalement et en appellent à une « indulgence » qui n’a pas lieu d’être. En passant d’un questionnement sur l’identité de ces croyants censément « monolingues » à une interrogation sur l’identité des problèmes publics sur lesquels l’« objection intégraliste » se règle et auxquels elle ouvre un boulevard, je déplace ensuite l’enquête vers les conséquences socio-politiques du tournant post-séculariste promu par Jürgen Habermas.
Je l’ai dit, l’« objection intégraliste » consiste à légitimer la capacité des citoyens et des acteurs publics à se mobiliser et à user de raisons strictement et uniquement religieuses pour fonder des décisions politiques, sans qu’ils aient à se justifier plus avant en s’appuyant sur des raisons publiques séculières (et donc non sectaires). Jürgen Habermas estime que « s’ils ne trouvent aucune "traduction" séculière, il doit », néanmoins, « leur être permis d’exprimer et de fonder leurs convictions dans la langue de leur religion » (Habermas, 2008, p. 189), parce qu’il en irait de leur identité et de leurs engagements les plus profonds. Pour voir si cette permission est raisonnable, il faut se demander quels sont les sujets pour lesquels ces citoyens « ne trouvent aucune "traduction" séculière ».
Lorsqu’on fait cet exercice, on se rend compte que s’il y a bien un genre d’incapacité au travail, elle n’est pas relative à l’incapacité de certains citoyens à prendre part à l’espace public, elle concerne plutôt l’incapacité de sujets bien précis à faire l’objet d’une politisation sans recourir à la force conative et au contenu cognitif de convictions qui se disent « religieuses » et sont manipulées à bon compte par des acteurs peu recommandables. Dans l’espace public états-unien (mais pas seulement), il existe des sujets de mobilisation collective qui ne doivent leur virulence qu’à des motifs strictement et uniquement « religieux ». On peut y compter le créationnisme, l’opposition à l’égalité des personnes homosexuelles, la lutte contre la légalité des interruptions volontaires de grossesse (voire de la contraception) et plus récemment la dénégation des effets des activités de l’homme sur le climat. La persistance de ces mobilisations doit pratiquement tout à l’instrumentalisation politique de raisons censément « religieuses ».
Opter pour la voie post-séculariste ne revient donc ni à éviter que la modernité ne « déraille », ni à rééquilibrer les charges de la participation, comme le pense Jürgen Habermas. Sur ce dernier point, il ne tient pas assez compte de « l’excès de déférence envers les croyances qui sont dites "religieuses" » et « qui décourage quiconque de critiquer une religion aussi pernicieuse et absurde soit-elle » (Morgan, 2008, p. 296). Sa position a pour conséquence d’accorder aux partisans de l’engagement politique des convictions religieuses à la fois une force spéciale et une immunité spécifique.
Jürgen Habermas compte en effet sur cette « force » : « les traditions religieuses possèdent, pour articuler les intuitions morales, notamment lorsqu’elles touchent aux formes du vivre-ensemble humain, une force particulière » (Habermas, 2008, p. 188). Mais comme ne cesse de le montrer l’actualité et la teneur même des textes censément « sacrés », il convient aussi de dire que les traditions religieuses possèdent, pour éclipser les intuitions morales et détruire le sens de la réalité, notamment lorsqu’ils touchent aux formes sensibles d’un vivre ensemble humain et non-humain, une force particulière. En raison de l’exploitation dont fait l’objet cette « force particulière », plutôt que de libérer sans réserve la parole religieuse, il est plus prudent de la canaliser, d’abord en veillant à ne pas lui offrir un « passe » dans l’espace public (Hollinger, 2008), ensuite en continuant à la soumettre à des enquêtes sur son origine, son statut, son contenu et ses conséquences.
Pendant longtemps, ces enquêtes furent menées par les sciences sociales et historiques, qui n’ont pas été pour rien dans l’heureuse sécularisation de l’espace public et dans ce que Paul Ricœur décrivait comme la transformation « post-religieuse » de la foi. Ces dernières années, elles ont largement abdiqué cette posture critique. Il est grand temps qu’elles la regagnent et il serait bienvenu qu’elles n’embrassent pas les discours post-sécularistes sans y réfléchir à deux fois. On s’étonnera ainsi de voir que le sociologue Jean-Noël Ferrié, pour s’opposer au « naturalisme » réductionniste des sciences cognitives, enfourche un schème apologétique de Peter Van Inwagen (2010), en accordant aux croyants fondamentalisés qui peuplent le champ de la philosophie analytique de la religion qu’« on peut expliquer raisonnablement les conduites humaines par le dessein divin » et en reprochant « aux partisans de l’approche naturaliste » de ne pas admettre « de parité entre le recours à la causalité divine et le recours à la causalité naturelle » (Ferrié, 2012). Visiblement, Jean-Noël Ferrié n’a pas conscience de l’hostilité de cette philosophie aux sciences sociales.
Au regard de ce qui s’y énonce et des arrière-pensées de ceux qui les ont alimentés, les discours post-sécularistes apparaissent comme un symptôme et comme un véhicule d’une inquiétante désécularisation des appuis du jugement public. La sociologie devrait y résister, au lieu de l’accompagner benoîtement. Pour cela, il faut questionner ce que l’on tient trop souvent pour des vertus académiques et politiques. Je pense ainsi à la tolérance, qui peut s’abimer dans une déférence de principe accordée aux croyances religieuses, aussi déraisonnables soient-elles, ou dans une indifférence trop polie à leur égard. Il en va de même du principe de démocratisation des sciences et d’« égale dignité » des « ontologies » (Latour, 2012), qui peut faire le jeu des pires forces réactionnaires. Il est temps de réfléchir sérieusement à ce que doit être un « pluralisme sans relativisme » (Thévenot, 1992) et de ne plus se laisser paralyser par des scrupules inappropriés face à certaines mobilisations politico-religieuses, trop vite accueillies au nom d’une conception de la démocratie qui se veut « radicale » et refuse de discriminer entre la variété des voix qui s’expriment.
Il serait opportun pour les sciences sociales de renouer avec la position de John Dewey 26, qui ne s’embarrassait pas de tels scrupules et posait sans détour la supériorité des « experts » sur un mauvais genre de « public », jugeant ainsi le populisme des fondamentalistes protestants :
« Considérons par exemple la tentative de recourir à la loi afin de décider si les légendes d’un peuple hébreu primitif concernant la genèse de l’homme font plus autorité que les résultats de l’enquête scientifique ; voilà un cas typique du genre de situation qui est voué à se produire si l’on accepte la doctrine suivant laquelle c’est un public organisé pour la défense de buts politiques qui est le juge et l’arbitre final des questions débattues et non des experts se fondant sur des investigations spéciales » (Dewey, 2003a, pp. 138-139).
Ceux qui se sont empressés de faire de John Dewey une référence dans leur lutte contre les privilèges de l’expertise scientifique ne l’ont manifestement pas bien lu :
« Il est vrai que l’enquête est un travail qui incombe aux experts. Leur qualité d’expert ne se manifeste toutefois pas dans l’élaboration et l’exécution des mesures politiques, mais dans le fait de découvrir et de faire connaître les faits dont les premiers dépendent. Ils sont des experts techniques au sens où les investigateurs scientifiques ou les artistes manifestent une expertise. Il n’est pas nécessaire que la masse dispose de la connaissance et de l’habileté nécessaires pour mener les investigations requises ; ce qui est requis est qu’elle ait l’aptitude de juger la portée de la connaissance fournie par d’autres sur les préoccupations communes » (Ibid., pp. 198-199).
Là où Albert Ogien se désole de voir que John Dewey « admet paisiblement le rôle incontournable de l’expert » (Ogien, 2012, p. 7), je rappellerai qu’il tenait à l’œil le mouvement fondamentaliste et réagissait à la résistance de cette coalition de croyants conservateurs à l’extension de la méthode de l’enquête aux choses sociales, religieuses et politiques 27. John Dewey considérait donc à raison que le « public » doit être éduqué, en veillant a minima à le rendre capable d’identifier « les opinions qui n’ont pas été touchées par l’esprit et la méthode scientifiques » et de distinguer « entre les choses de l’opinion et celles relatives aux faits et à l’établissement des faits » (Dewey, 1998b, p. 352). Mais cette éducation devient impossible si les sciences sociales se laissent enrôler dans une entreprise de désécularisation de la raison publique.
On pourrait ici conclure sur d’autres disciplines vulnérables aux idéologues religieux. Peu de sociologues l’ont noté, mais la « Reformed Epistemology » est actuellement importée en sciences cognitives. Le champ de la « Cognitive Science of Religion » (Clark & Barrett, 2010et 2011 ; De Cruz & De Smedt, 2012) est le tout dernier espace académique colonisé par des croyants fondamentalisés, Justin L. Barrett en tête, récemment gratifié d’un centre de recherche au Fuller Theological Seminary, bastion évangélique 28. Qu’ils le veuillent ou non, les psychologues et anthropologues évolutionnaires font le jeu d’une désécularisation de l’espace public, à force d’arguer du caractère « naturel », involontaire, incorrigible, universel, fonctionnellement adaptatif et socialement profitable des croyances en une agentivité surnaturelle. En effet, à quoi bon vouloir que les institutions publiques soient sécularisées, s’il s’avère que les croyances religieuses sont foncièrement irrépressibles et bénéfiques d’un point de vue évolutionnaire ?
La greffe d’une apologétique fondamentaliste sur cette discipline est d’autant plus aisée que les épistémologues « réformés » et les psychologues ou anthropologues évolutionnaires partagent une même conception de la cognition ; les uns et les autres ayant une vision de l’« agent épistémique » comme d’une « machine à input/output », tous tendent à faire des croyances « passives » ou « non-réflexives » le « paradigme » du savoir humain (Axtell, 2006, p. 138). Sans choquer grand monde, Kelly James Clark et Justin L. Barrett peuvent alors écrire que « les chercheurs en sciences cognitives ont apporté une bonne raison empirique de croire ce que certains philosophes et théologiens affirment sur des bases théologiques : nous avons une disposition naturelle à croire en Dieu », « un sensus divinitatis »… (Clark & Barrett, 2011, p. 11).
Notes
1.Je ne m’y attache pas à ce que Dominique Guillo nomme le « créationnisme à la française », décrivant la manière dont la théorie de l’évolution est souvent enseignée ou comprise en France : « la conception de l’évolution qui domine en France, en dehors des spécialistes en biologie, se ramène en réalité à une sorte de créationnisme très particulier, laïque, sécularisé, qui souscrit pleinement à l’idée d’une transformation des espèces, met à distance la religion et se perçoit comme conforme à la science » (Guillo, 2013, p. 181).
2. En 2005, le sociologue des sciences Steve Fuller, spécialiste de Thomas S. Kuhn, a témoigné en faveur de l’Intelligent Design lors du procès Kitzmiller v. Dover board. Sur ce procès, cf. Mathias Girel (2012).
3. Cette philosophie est « dominée » par des « approches chrétiennes fondamentalistes » et les principaux « philosophes analytiques de la religion (considérés comme mainstream) argumentent en faveur de doctrines créationnistes » (Levine, 2010, p. 345).
4. Cf. aussi Unmodern philosophy and modern philosophy (Dewey, 2012).
5 Expression que Roger Pouivet emploie volontiers (Pouivet, 2002, p. 24).
6. Le front qu’ils ouvrirent contre les théologies libérales est homologue à l’opposition de Roger Pouivet à la « philosophie continentale », où il met dans un même paquet des auteurs aussi divers que Ludwig Wittgenstein, Jacques Derrida, Jean-Luc Marion, Paul Ricœur, Michel Henry, Karl Marx, Sigmund Freud, Claude Levi-Strauss (mais aussi les sciences sociales en général), en leur reprochant leur « anti-réalisme » théologique. Bien qu’il soit catholique, en un geste typiquement fondamentaliste, Roger Pouivet laisse entendre que ceux qui, parmi ces auteurs, sont croyants, ne pourraient prétendre au titre d’authentiques chrétiens car ils n’ont pas défendu la vérité « théorique » et la « valeur épistémique » des dogmes du christianisme (Pouivet, 2012). À croire qu’il les tient pour coupables d’avoir alimenté « une conception ramollie de la religion » qui « délaisse le contenu propositionnel du Credo et la métaphysique que sa défense suppose » (Pouivet, 2011). Et ce serait à cause de cette « conception ramollie de la religion » qu’« on ne craint plus l’enfer », « qui reste pourtant ce qui est promis au pêcheur qui ne se repent pas, non ? » ajoute-il (Ibid., 2012).
7. Peter Van Van Inwagen fait étalage de ses amitiés avec Philip Jonhson (stratège en chef de l’Intelligent Design) et David Berlinski (également membre du Discovery Institute) dans The Possibility of resurrection and other essays in Christian apologetics (Van Inwagen ; 1998, p. 17).
8. Cf. aussi Gonzalez & Stavo-Debauge (2012). Sur le transport des schèmes théocratiques de la droite chrétienne américaine dans l’évangélisme francophone, cf. l’important livre de Philippe Gonzalez (2014a).
9. Par exemple Nicholas Wolterstorff (1997) ou Christopher Eberle (2002), tous deux évangéliques ; le premier est le plus cité dans l’article « Religion and political theory » que le second a co-écrit avec Terrence Cuneo pour la Stanford Encyclopedia of Philosophy (Eberle & Cuneo, 2008). Pour donner une idée du poids de ces personnages, notons que cette encyclopédie fait état de 122 entrées se référant à Alvin Plantinga (qui y signe l’entrée « Science and Religion » en citant favorablement Michael Behe, porte-flingue du Discovery Institute), contre seulement 105 à Jurgen Habermas, 105 à Henri Bergson et 33 à Gilles Deleuze.
10. Ce trope est souvent utilisé à des fins apologétiques, ainsi dans le travail de l’anthropologue Tanya Luhrmann sur les évangéliques, When God Talks Back (2011). L’historienne Molly Worthen se demandera si Tanya Luhrmann « avait jamais engagé la conversation avec ses sujets sur le mariage gay ou la théorie de l’évolution » ; « on ne peut rendre compte de l’histoire des évangéliques et de leur rôle en politique sans prêter attention à la substance de leurs croyances et aux leçons sociales et scientifiques que leur communauté leur apprend à tirer de la Bible » (« A Great Awakening », The New York Times, 27 avril 2012). Tanya Luhrmann arguera plus tard que « si on met de côté le problème de la croyance – et si on ne se laisse pas distraire par la question politique – il est plus facile de voir que la vision du monde des évangéliques est pleine de joie » (« Belief is the Least Part of Faith », The New York Times, 29 mai 2013). David Hollinger lui répondra que « la croissance des églises évangéliques a bien quelque chose à voir avec les idées particulières que ces églises proclament et protègent bien souvent de tout examen critique » (Lettre aux éditeurs, The New York Times, 4 juin 2013). Pour une discussion critique de Tanya Luhrmann, cf. l’introduction du livre de Philippe Gonzalez (2014a). Méthodologiquement, « ne pas croire à la croyance » ne constitue pas une bonne maxime descriptive pour aborder les religions ; Michael Dummett considérait même qu’une telle « thèse » est « paradoxale », elle revient à dire que « la foi ne requiert aucune croyance » (Dummett, 2010, p. 39). Dans les communautés et institutions religieuses conservatrices, on peut estimer dire que « la majorité des gens croient à la croyance en Dieu ; ils croient que cette croyance est un état de chose auquel chacun doit aspirer, qu’il leur faut travailler à conserver et faire partager aux autres – et ils se sentent coupables ou sont consternés s’ils y échouent » (Dennett & Lascola, 2010, pp. 125).
11. Plus radical que John Rawls, John Dewey considérait qu’il était « impossible » aux Églises « de participer à la promotion des fins sociales dans un cadre naturel et humain puisqu’elles revendiquent sinon un monopole des valeurs suprêmes, du moins une relation privilégiée à ces valeurs » et qu’il leur fallait « impérativement renoncer à leur position d’autorité et à leurs prétentions » si elles voulaient « sortir de leur domaine réservé » (Dewey, 2011, p. 175). Dans cette veine, je dirai donc avec Philip Kitcher qu’on doit « exclure » de la raison publique « les appels aux lectures littéralistes des textes religieux non parce qu’elle introduisent des raisons qui ne sont pas partagées par tous les participants, mais tout simplement parce qu’elles sont fausses » ; « les mensonges doivent être évités et il n’y a aucune raison de penser que les mensonges religieux devraient être traités différemment des autres sortes de mensonge » (Kitcher, 2011a, pp. 344-345). Néanmoins, Philip Kitcher fait droit à la « spiritual religion », qui a rompu avec le surnaturalisme, l’absolutisme, la vérité des dogmes de la foi et la lecture littérale des textes « sacrés » (Kitcher, 2007a & b ; 2011b). Il est moins radical que John Dewey. Aussi sévère avec les croyants modernistes qu’avec les fondamentalistes (ou les catholiques théologiquement conservateurs), John Dewey leur posait une même question : « avec quelles méthodes la croyance vraie est-elle atteinte et testée ? » (Dewey, 1998a, p. 350). Si Williams James s’inquiétait de « l’impact éthique d’un empirisme trop étroitement défini », John Dewey voyait dans l’empirisme « une manière de pensée gravement menacée par une culture profondément religieuse » et se chargea de « défendre la connaissance empirique contre tous ceux qui considéraient qu’elle était contraire aux principes chrétiens » (Jewett, 2012, p. 96). Pour autant, s’il fut « incapable d’accepter les prémisses théologiques des théories éthiques chrétiennes », John Dewey « coopéra politiquement avec les chrétiens libéraux » (Ibid., 2012).
12. Mais pas économique, ces mouvements étant souvent des apologètes du capitalisme le plus effréné. Il n’est pas étonnant que certains sociologues s’enthousiasment de la réussite des évangéliques en ayant recours au lexique du « marché » et de la « compétitivité », ce lexique étant isomorphe au fonctionnement et à l’idéologie du monde évangélique. Pour une remarquable critique de ces analyses enjouées en termes de « marché », cf. Gonzalez (2014a).
13. Philippe Gonzalez développe cet intérêt de Michel Certeau pour ce qui « fait marcher » les croyants (Gonzalez, 2014b), informé par une solide ethnographie des évangéliques, il se montre aussi très méfiant de la valorisation de l’« effervescence collective » dans la sociologie d’Émile Durkheim.
14. Bruno Karsenti joue aussi dangereusement avec cette idée de « politique de l’esprit » et semble pareillement fasciné par le théologico-politique dans son Moïse et l’idée de peuple : « le sens de la politique s’éclaire dans la structure d’élection d’un peuple qui le lie à sa loi, par l’intervention d’un personnage tel que Moïse, un grand législateur qui entend Dieu », « la politique, en d’autres termes, ne serait touchée comme telle que dans la structure de la religion monothéiste » (Karsenti, 2012, p. 64).
15. De nombreux philosophes et théologiens contemporains attendent après un nouveau Moyen-Âge, glorieuse période où le théologique surplombait l’ensemble des savoirs, où le religieux n’était pas séparé du politique et où le sacré régnait sur le séculier. Ce rêve est explicite dans le puissant courant de la « Radical Orthodoxy », initié par John Milbank (qui a co-écrit un livre avec Slavoj Zizek) ; sur ce courant, cf. Jeffrey Stout (2004). En France, Rémi Brague plaide lui aussi pour un « nouveau Moyen-Âge » (Brague, 2013, p. 250). Il argue que « seul le commandement divin légitime l’être en le déclarant "bon" » (Ibid., p. 238) et que « la reprise d’un effort du type de celui du Moyen-Âge représente une possibilité encore actuelle, voire inévitable », car « sans une foi en un Dieu à la fois créateur et provident, analogue à celle que défendaient les grands penseurs médiévaux, l’existence de l’homme perd sa légitimité » (Ibid., pp. 246-247).
16. Où le syntagme « Dieu » ne joue strictement aucun rôle explicatif ; à part dans les départements conquis par la philosophie analytique de la religion…
17. Exploitant pour cela la tolérance libérale, dont les règles de civilité rendent le libéralisme politique vulnérable aux attaques de ces croyants fondamentalisés.
18. Les résultats des enquêtes scientifiques rendent intenables l’affirmation de l’inerrance des textes censément « sacrés ». Paul Ricœur rendait grâce au « choc en retour des disciplines critiques, philologiques et historiques sur les textes sacrés » (Ricœur, 2013 p. 510). Saluant Karl Marx, Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud, il ne craignait pas d’écrire que « nous sommes désormais incapables de restaurer une forme de vie morale qui se présenterait comme une simple soumission à des commandements, à une volonté étrangère ou suprême, même si cette volonté était représentée comme volonté divine » et que « nous devons tenir pour un bien la critique de l’éthique et de la religion menée par l’école du soupçon » (Ibid., p. 585).
19. Sur cette grammaire, disposée parmi d’autres grammaires du commun, cf. Laurent Thévenot (2012 et 2013).
20. Mais qui ne fonctionnerait pas toujours, certains d’entre nous étant aveuglés par les « effets noétiques du péché », ce qui nous empêcherait de reconnaître la réalité de Dieu et la vérité de ses révélations bibliques ; mais le Saint Esprit pourrait y remédier… On mesure l’écart avec un protestant libéral comme Paul Ricœur, pour qui « le concept de péché originel est un faux-savoir et il doit être brisé comme savoir ; savoir quasi juridique de la culpabilité des nouveaux-nés, savoir quasi biologique de la transmission d’une tare héréditaire, faux-savoir qui bloque dans une notion inconsistante une catégorie juridique de dette et une catégorie biologique d’héritage » (Ricœur, 2013, p. 364). Le pseudo argument d’Alvin Plantinga provient de l’apologétique néo-calviniste d’Abraham Kuyper, dont Nicholas Wolterstorff se revendique également (cf. Le Loup dans la bergerie). Les schèmes théologico-politiques mis en circulation par Abraham Kuyper ont inspiré la radicalisation de la droite chrétienne américaine (Gonzalez & Stavo-Debauge, 2012), qui a fait son miel de la célèbre phrase du théologien et homme politique hollandais : « Il n’est pas de domaine dans la vie des hommes dont le Christ, qui est souverain sur tout, ne puisse dire : "C’est à moi" ! ». Ces schèmes ont été assimilés par le monde évangélique francophone, comme Philippe Gonzalez le montre (Gonzalez, 2014a).
21. Y compris sur des sujets scientifiques, où les « vérités révélées » doivent aussi prévaloir. Dans Reason within the Bounds of Religion, Nicholas Wolterstorff posait que les croyances chrétiennes « doivent fonctionner comme un critère de contrôle des théories [scientifiques] que nous [les évangéliques] voulons bien accepter » (Wolterstorff, 1976, p. 73).
22. Nicholas Wolterstorff est plus explicite lorsqu’il s’adresse à ses coreligionnaires évangéliques. Dans « Theological Foundations for an Evangelical Political Philosophy », il écrit que « l’ordre providentiel du plan divin pour le temps présent assigne au gouvernement la formidable tâche de médiatiser le jugement de Dieu » (Wolterstorff, 2005, p. 140) et que « l’autorité du Christ inclut l’autorité politique », il « n’est pas seulement à la tête de l’Église mais aussi à la tête de l’État » (Ibid., pp. 151-152). Comme je le signale dans mon livre, cette variation du niveau d’explicitation des objectifs théologico-politiques, plus ou moins accentués selon les publics visés, est aussi propre aux stratégies rhétoriques des créationnistes et des entrepreneurs du religieux évangélique. Sur ce point, cf. aussi Philippe Gonzalez (2014a).
23. Jürgen Habermas appelle ainsi « l’État constitutionnel » à « se montrer indulgent à l’égard de toutes les sources culturelles auxquelles s’alimentent la conscience normative » (Habermas, 2008, p. 166).
24. Les stratèges du Parti Républicain ont largement participé à faire de l’avortement un motif de réalignement électoral des évangéliques (Williams, 2011 ; Greenhouse & Siegel, 2011).
25. Pour un aperçu de cette hostilité, cf. Michon & Pouivet (2010).
26. Finalement très proche de celle de Bertrand Russell. Sur ce dernier, cf. Jacques Bouveresse (2010).
27. Le « naturalisme culturel » de John Dewey fournit un antidote au « réalisme théiste » des néo-créationnistes (Capps, 2000). Pour un aperçu de ce naturalisme, différent de celui des sciences cognitives contemporaines, cf. la réaction de Louis Quéré (2011) au texte de Laurence Kaufmann et Laurent Cordonier sur le « naturalisme social » (Kaufmann & Cordonier, 2011).
28. La « Cognitive Science of Religion » est largement financée par la richissime Templeton foundation, qui a déjà alloué plusieurs millions de dollars à Justin L. Barrett et publié un de ses livres (Barrett, 2011). Souvent comptée comme un acteur majeur d’une forme plus subtile de créationnisme (Lecointre, 2012 ; Baudoin & Brosseau, 2013), cette fondation est boycottée par plusieurs éminents scientifiques et philosophes, qui refusent de participer à son prosélytisme et n’acceptent pas que son actuel président fasse (à titre privé) d’importantes donations à des causes des plus douteuses (dénégation de l’existence du réchauffement climatique, opposition à l’égalité des personnes homosexuelles, et cetera). Active dans le champ des sciences sociales et des Humanités, cette fondation n’est pas étrangère à la propagation de l’idée de post-sécularisme dans nos disciplines, comme je le signale dans mon livre.
Référence électronique
Joan Stavo-Debauge, « Grand résumé de Le Loup dans la bergerie. Le fondamentalisme chrétien à l’assaut de l’espace public, Paris, Les Éditions Labor et Fides, 2012 », SociologieS [En ligne], Grands résumés, Le Loup dans la bergerie. Le fondamentalisme chrétien à l’assaut de l’espace public, mis en ligne le 19 novembre 2013, consulté le 27 janvier 2014. URL : http://sociologies.revues.org/4524
Auteur
Joan Stavo-Debauge
CRIDIS, Université catholique de Louvain (Belgique) - j.stavo-debauge@voila.fr
http://sociologies.revues.org/4526
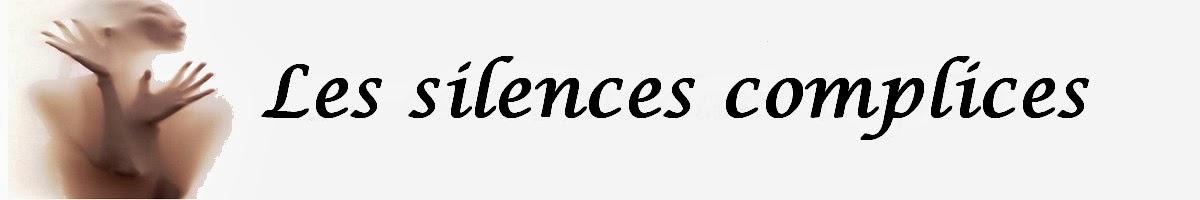
Aucun commentaire:
Publier un commentaire